Autocratie, dictature, tyrannie, fascisme… Les termes pour qualifier l’exercice du pouvoir de Donald Trump sont nombreux. Mais celui qui représente sans doute le mieux la situation est celui que Max Weber appelait le pouvoir patrimonial. De nombreux auteurs ont déjà écrit sur le sujet.
S’il ce type d’exercice du pouvoir se distingue des premiers cités, il peut en partager certains attributs comme le culte du chef, l’inefficacité de l’administration des contre-pouvoirs, démonisation des adversaires transformés en ennemis. Donald Trump, ce n’est donc pas seulement un changement de politique – il a achevé la transformation du parti républicain en marche depuis Newt Gingrich – mais c’est aussi un changement dans la conception et l’exercice du pouvoir.
Donald Trump et l’ère du patrimonialisme : quand l’État devient une PME familiale
Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump n’a pas seulement changé de politique : il a transformé la nature même du régime américain. Ce qui peut être perçu comme une variante d’autoritarisme classique, est aussi un phénomène que le sociologue Max Weber avait identifié il y a plus d’un siècle : le patrimonialisme dont le caractère essentiel est la confusion entre privé et public. En France, on se souvient du « l’État c’est moi » décrété par Louis XIV devant en 1685 devant des parlementaires qui contestaient ses édits (l’équivalent des décrets que signe à tour de bras l’actuel président).
Dans un État moderne, la légitimité repose sur ce que Max Weber appelait la rationalité bureaucratique : des règles impersonnelles, une administration professionnelle, des institutions qui survivent aux individus. Le président, comme tout fonctionnaire, prête serment non à une personne, mais à la Constitution. Un gouvernement caractérisé par la célèbre formule “A Government of Laws, Not of Men” de John Adams qui est devenu le deuxième président des États-Unis.
Donald Trump a brisé ce principe fondateur. Formé à la direction d’une PME familiale sans conseil d’administration ni contre-pouvoirs, il transpose cette logique à l’État : chaque ministère devient une annexe de son empire, chaque décision un prolongement de son intérêt personnel. Les nominations se font sur la base de la loyauté, non de la compétence. La justice est traitée comme son cabinet d’avocats privé – les numéros un et deux du ministère de la Justice ont un de ses avocats dans un cadre privé -, les affaires publiques comme son patrimoine. Il parle généralement des juges et des généraux comme “my generals” ou “my judges”. Il démet de ses fonctions d’un coup de plume ou d’un tweet, tous ceux de la haute administration qui ne lui plaisent pas. Ou en utilisant de faux arguments. Par exemple, dans le cas de Lisa Cook, une des directrices du board de la FED qu’il accuse faussement de corruption.
Ainsi, la frontière entre l’intérêt national et l’intérêt de Trump s’efface. C’est la définition même du patrimonialisme : un gouvernement où l’État n’existe pas comme entité autonome, mais comme propriété personnelle du chef.
Ce mode de pouvoir n’est pas nouveau, mais il était inconnu jusqu’ici aux États-Unis. On le retrouve dans la Russie de Vladimir Poutine, la Turquie de Recep Tayyip Erdoğan, la Hongrie de Viktor Orbán ou l’Inde de Narendra Modi. Tous ont cherché à gouverner non à travers des institutions solides, mais par réseaux de clientèle, punissant les ennemis, récompensant les fidèles.
Max Weber pensait que ce modèle ne pourrait survivre à l’ère des États modernes, où la complexité des sociétés et des économies exige expertise et procédures. Il avait raison sur un point : le patrimonialisme est structurellement inefficace. L’arbitraire du chef bloque la bonne marche des administrations. Les meilleurs fonctionnaires s’en vont ou sont démis de leurs fonctions, les agences s’affaiblissent, les décisions deviennent incohérentes, prises sur un coup de tête. L’exemple du ministère de la Santé dont on peut penser qu’il doit être géré en fonction de critères scientifiques et non idéologiques. Que Robert Kennedy Jr, son ministre, décide de politique de santé publique en fonction de ses propres croyances ne peut que mener à la catastrophe.
Dans le cas américain, cela se traduit par une gestion erratique des crises sanitaires, par la paralysie de programmes sociaux, ou encore par la désorganisation de la diplomatie et de la sécurité nationale.
L’autre conséquence est plus corrosive encore : la corruption systémique. Celle-ci est déjà assez largement présente en fonction de la très forte influence de l’argent dans la politique. L’arrêt Citizens United v. Federal Election Commission (21 janvier 2010) de la Cour suprême des États-Unis concernant le financement des campagnes électorales avait grand ouvert les vannes. Au fondement de cet arrêt, la conception pour le moins étrange qu’une entreprise peut être considérée comme une personne. Les entreprises et syndicats ont le droit au même titre que les individus d’exprimer des opinions politiques, y compris par le financement de communications indépendantes (spots TV, films, publicités, etc.). Il est clair que les premières ont des moyens financiers largement supérieurs au second et, bien sûr, aux citoyens. Il stipule que l’interdiction prévue par la loi McCain-Feingold violait le Premier Amendement (liberté d’expression) et que les restrictions sur les financements indépendants de campagnes par des entités collectives (corporations, syndicats) sont inconstitutionnelles.
Un tel régime vit de la confusion entre pouvoir politique et intérêts privés. Les proches du président sont enrichis par des contrats publics, les alliés politiques blanchis de leurs crimes, les adversaires accablés par une justice instrumentalisée.
Comme le soulignent Stephen Hanson et Jeffrey Kopstein, auteurs de The Assault on the State, la corruption n’est pas un accident du patrimonialisme : c’est sa raison d’être. On pourrait ajouter qu’elle correspond bien au caractère de l’actuel président. Gouverner, dans ce système, signifie exploiter l’État comme une rente. C’est ce que Trump a fait en traitant la Maison-Blanche comme une opportunité d’affaires, en mêlant négociations diplomatiques et deals immobiliers, sans parler des en offrant à ses alliés politiques une immunité de fait.
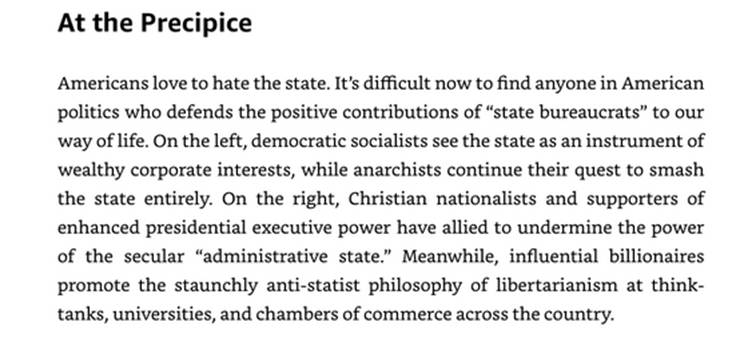
Certes, Trump est arrivé au pouvoir par les urnes. Mais le patrimonialisme est antinomique avec la réelle démocratie. Celle-ci repose sur des institutions stables, des règles égales pour tous, des contre-pouvoirs effectifs. Le patrimonialisme, lui, détruit méthodiquement ces garde-fous.
Les processus électoraux eux-mêmes sont fragilisés : le chef se présente comme le seul garant du peuple, délégitimant toute opposition comme ennemie de la nation. C’est un chemin glissant : nombre de régimes patrimoniaux basculent tôt ou tard dans l’autoritarisme pur, lorsque l’érosion des institutions devient irréversible. La perspective des élections de mi-mandat le prouve largement. Pour éviter une probable perte de contrôle de la Chambre des représentants, et peut-être du Sénat, il a lancé directement ou indirectement toute une série d’initiatives pour orienter le résultat du vote en sa faveur. Le plus éclatant est la demande de gerrymandering au gouverneur du Texas qui s’est mis à exécution le doigt sur la couture du pantalon. Une manœuvre qui pourrait rapporter cinq sièges aux républicains. Il y a aussi la prise de contrôle du processus électoral au niveau fédéral, là où le système était traditionnellement géré par les États, précisément pour éviter toute manipulation.
À court terme, un régime patrimonial peut donner l’illusion de la puissance : décisions rapides, absence de débats, culte de la personnalité. Mais sur la durée, il est condamné à l’inefficacité et à la dérive prédatrice. Ni les infrastructures, ni l’économie, ni la sécurité nationale ne peuvent prospérer durablement dans un système où la compétence est suspecte et où l’intérêt général est relégué derrière l’intérêt du clan.
Trump, en ce sens, n’invente rien : il reproduit un modèle archaïque, incapable de répondre aux exigences d’une grande démocratie moderne. Mais en l’installant au cœur de la première puissance mondiale, il ouvre une ère de fragilité institutionnelle dont les États-Unis — et, par ricochet, leurs alliés — mettront longtemps à se relever.

