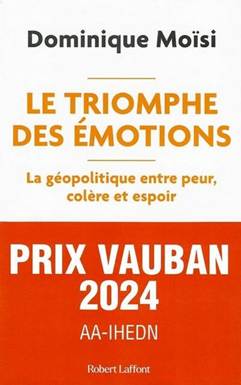
Moins de faits, plus d’émotions, telle est la tendance observée une équipe de chercheurs dans une étude intitulée « Computational analysis of US congressional speeches reveals a shift from evidence to intuition », publié dans Nature Human Behaviour (juin 2025). Cette étude révèle un changement profond dans la manière dont les parlementaires américains s’expriment. Selon les auteurs, le langage du Congrès a changé de nature, avec des conséquences alarmantes pour la santé démocratique des États-Unis. Ce glissement avait été remarqué par le politologue Dominique Moïsi dans son livre Le Triomphe des émotions.
Une analyse sur 145 ans de débats parlementaires révèle un tournant inquiétant : les élus américains s’appuient de moins en moins sur les faits dans leurs discours. Pourquoi ce glissement vers l’intuition et l’émotion, et que nous dit-il sur l’état de la démocratie ?
C’est une bascule discrète, mais lourde de sens. Selon une étude publiée en juin 2025 dans Nature Human Behaviour, le langage factuel a progressivement déserté les discours du Congrès américain. À sa place ? Un langage fondé sur les émotions, les croyances personnelles, l’intuition.
Les chercheurs, issus de plusieurs universités européennes, ont analysé plus de 8 millions de discours prononcés entre 1879 et 2022. En combinant intelligence artificielle et analyse sémantique, ils ont construit un indice appelé EMI (Evidence Minus Intuition). Son rôle : mesurer, à chaque session du Congrès, la part de langage fondé sur des faits par rapport à celui fondé sur l’intuition.
Le résultat est sans appel : le pic de langage factuel a été atteint en 1975, au cœur de l’après-Watergate et d’un regain d’exigence démocratique. Depuis ? Une chute continue, jusqu’à atteindre un niveau historiquement bas en 2022. Fait marquant : ce déclin est bipartite. Démocrates et républicains utilisent moins de langage basé sur des données. Mais la baisse est bien plus forte côté républicain, surtout depuis la fin des années 2000.
Ce recul du langage fondé sur les preuves n’est pas un phénomène isolé. Il accompagne – et parfois précède – trois évolutions majeures de la vie politique américaine :
- Une polarisation croissante, où les partis ne se parlent plus, mais se confrontent.
- Une hausse des inégalités, notamment au profit du 1 % le plus riche.
- Une baisse de la productivité législative, avec moins de lois votées, et moins de lois majeures.
Autrement dit, moins on parle en s’appuyant sur les faits, plus la démocratie se grippe. Le langage n’est pas qu’un symptôme, c’est un rouage.
Les chercheurs identifient plusieurs facteurs de cette dérive :
- Le pouvoir accru des chefs de partis, qui encadrent les prises de parole.
- La montée en puissance de la présidence, qui marginalise le débat parlementaire.
- La logique médiatique, surtout depuis que C-SPAN retransmet les débats (1979). Le Congrès devient une scène plus qu’un lieu de discussion.
- Les temps de parole raccourcis, qui empêchent l’argumentation approfondie.
- La pression des électeurs et des donateurs, qui poussent à des discours émotionnels, identitaires, clivants.
Tout cela crée un climat où convaincre par la preuve est moins valorisé que rassembler sa base par l’émotion.
Dans une démocratie, le langage fondé sur les faits n’est pas un simple choix rhétorique. C’est une condition de possibilité du débat. Quand les élus s’appuient sur les mêmes chiffres, les mêmes réalités, ils peuvent débattre, argumenter, négocier. À l’inverse, un discours fondé uniquement sur l’intuition enferme chacun dans ses convictions. Il empêche toute forme de compromis. Et quand plus rien ne peut être discuté rationnellement, c’est la démocratie elle-même qui recule.
Mais les chercheurs ne se contentent pas de tirer la sonnette d’alarme. Ils dessinent des pistes pour inverser la tendance :
- Favoriser les initiatives transpartisanes, qui réintroduisent du dialogue fondé sur les faits.
- Réformer les règles du Congrès pour permettre des débats plus profonds.
- Former les élus et leurs équipes à l’argumentation rationnelle, à la vérification des sources, à l’écoute active.
Et surtout : revaloriser socialement le langage de la preuve, dans les médias, les campagnes, les institutions. Parce que les faits ne sont pas ennuyeux : ils sont le socle de notre contrat démocratique.

