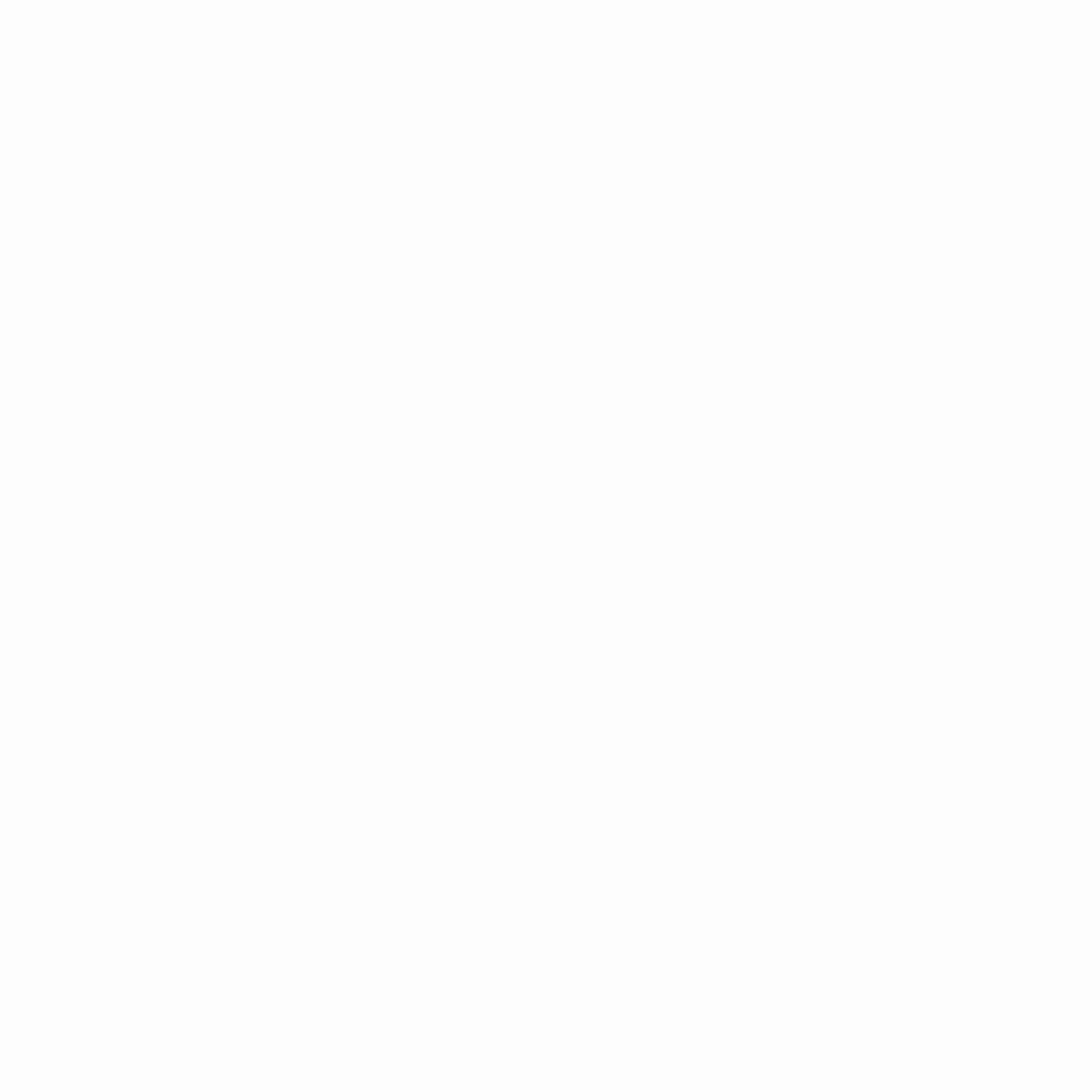Ceci est une fiction.
On ne parla jamais d’occupation.
Le mot avait disparu des communiqués, remplacé par des expressions plus souples, plus respirables : assistance, stabilisation, partenariat renforcé. À La Havane, les façades coloniales continuaient de s’écailler avec dignité, mais derrière les persiennes, quelque chose avait changé. Ce n’était pas un bruit de bottes. Plutôt un frisson, une pression invisible, comme si l’île elle-même retenait son souffle, consciente qu’on la déplaçait sans qu’elle puisse résister.
Les anciens du quartier murmuraient parfois, entre deux verres de rhum : « Ça ressemble à avant… mais ce n’est pas avant. » Les jeunes, eux, ne savaient rien de Batista ni de la Baie des Cochons ; pour eux, la mémoire était une fiction que les touristes photographiaient. Mais la ville respirait différemment. Les taxis tournaient plus vite, les billets de banque américains circulaient plus facilement, et les hôtels s’étaient parés de drapeaux invisibles que seuls certains visiteurs pouvaient voir.
Le pétrole vénézuélien avait cessé d’arriver sans fracas. Un jour, les réservoirs étaient pleins ; le lendemain, ils devinrent des monuments vides. Les bus ralentirent, puis s’arrêtèrent. Les générateurs toussèrent avant de se taire. Le Venezuela, étranglé ailleurs, n’avait plus rien à donner. Cuba, privée de ce sang noir, se retrouva soudain légère, presque transparente. Et dans cette fragilité nouvelle, il y avait un parfum d’opportunité.
À Washington, Donald Trump regardait une carte des Caraïbes sans vraiment la voir. Cuba n’était pour lui qu’une silhouette verte, un nom chargé d’échecs anciens. La Baie des Cochons le mettait mal à l’aise. Il n’aimait pas les défaites héritées. Il préférait les effacer, les recouvrir, comme on rebaptise un gratte-ciel après une faillite.
Marco Rubio, lui, se souvenait de tout. Dans l’ombre, il souriait, patient, calculateur. Il avait imaginé ce scénario depuis des années, et le moment était parfait : Trump croyait que toutes ces idées venaient de lui, alors qu’il n’était qu’une marionnette enthousiaste.
Il parlait doucement au président, avec cette patience qu’on réserve aux causes personnelles. Il ne parlait pas de revanche — jamais. Il parlait de réparation historique, de sécurité continentale, de leadership retrouvé. Il évoquait Batista sans le nommer, décrivait une époque de croissance, de lumière, de musique, en omettant soigneusement les prisons.
— “Monsieur le Président… vous savez, il y a un outil historique…”, dit Rubio d’un ton mielleux.
— “Un outil historique ? Je suis le président le plus historique de tous les temps !”, répliqua Trump.
— “Oui… mais je parle de l’amendement Platt. Réactivez-le. Cuba a besoin de leadership… de notre leadership.”
— “Bien sûr ! Moi j’y avais pensé ! Je pensais exactement à ça !”, s’exclama Trump, les yeux brillants, ignorant que Platt avait été abrogé en 1934. Rubio hocha la tête en silence, savourant sa victoire : il venait de transformer l’obsession de Trump pour sa propre gloire en un outil de pouvoir.
Voyant que son opération sur le Groenland patinait et que l’affaire Epstein menaçait toujours de ternir son image, Trump inventa une nouvelle crise. Cuba devint soudain le théâtre idéal pour détourner l’attention, justifiant l’injustifiable.
— “Il nous faut un prétexte ! Je veux un prétexte qui fasse oublier Epstein !”, ordonna Trump.
— “Monsieur… il suffit de laisser la situation se détériorer un peu… l’île s’ouvrira à nous naturellement,” murmura Rubio.
— “Parfait ! Je suis un génie ! Personne ne voit ça venir !”
Les diplomates américains avaient pris soin de ne jamais prononcer le mot « souveraineté ». Il était remplacé par *coordination*, *coopération*, *dialogue renforcé*. Les historiens se frottaient les yeux : ces formulations avaient l’air de concessions, mais le poids réel du pouvoir s’était déplacé, silencieusement.
Un soir, au détour d’un discours, Trump lâcha la phrase comme on lâche un ballon d’essai :
« L’amendement Platt n’était peut-être pas une erreur. »
Les juristes sursautèrent. Les historiens blêmirent. Mais personne ne parla trop fort. L’amendement avait été abrogé, oui, en 1934, par un autre Roosevelt, dans un autre monde. Mais les textes, comme les fantômes, ne meurent jamais vraiment. Il suffit de les invoquer autrement.
Le basculement commença en 2026. Des manifestations planifiées, des démissions soudaines dans des ministères clés, des pénuries localisées : tout avait été orchestré depuis des mois, par des réseaux américains et locaux, dans un ballet discret et cruel. Quand le président cubain céda enfin, il ne s’agissait pas d’un coup d’État clair. On parla d’“ajustement naturel des responsabilités gouvernementales”.
C’est alors que les avions revinrent.
Pas les avions militaires — ceux-là auraient rappelé de mauvais souvenirs — mais des jets blancs, brillants, pleins d’hommes en chemises claires et de femmes aux sourires professionnels. Ils parlaient d’hôtels, de ports, de données, de sécurité juridique. Ils parlaient vite, comme s’ils craignaient que l’île se souvienne. Leurs discours évoquaient des investissements stratégiques, des *programmes éducatifs*, des partenariats économiques, mais chacun savait, en silence, que tout était calculé pour que Cuba devienne un théâtre, à la fois brillant et docile.
À Bruxelles, on suivait l’affaire avec une attention polie. Les Européens soupiraient, un peu honteux, un peu soulagés. Trump parlait moins du Groenland ces temps-ci. Cuba, après tout, était loin. Cuba ne faisait pas partie des chaînes d’approvisionnement critiques, ni des débats climatiques urgents. Et puis, il y eut ces conversations feutrées, jamais écrites, jamais signées : *Laissez-lui Cuba, et il nous laissera le reste.* Un marché odieux, oui — mais pratique. L’Histoire est pleine de marchés pratiques.
Sur l’île, les enseignes changèrent de langue. Les casinos rouvrirent sous des noms neufs. La musique revint, plus forte, plus rentable. Les dollars circulaient mieux que les discours. Certains disaient que rien n’avait changé. D’autres disaient que tout était redevenu familier, comme un cauchemar ancien qu’on reconnaît sans parvenir à se réveiller.
Les enfants couraient dans les rues en criant des noms étrangers qu’ils n’avaient pas encore compris. Les pêcheurs ramenaient des filets moins abondants mais plus prisés par des acheteurs au sourire impeccable. Et chaque soir, le soleil tombait sur la baie, rougissant les eaux comme pour rappeler que l’île avait déjà vu cela avant — et que, peut-être, elle le reverrait encore.
On ne parla toujours pas de contrôle.
Mais chacun comprenait que Cuba, une fois encore, n’était plus tout à fait à elle-même.
Et que l’Histoire, patiente et cruelle, venait de réussir ce qu’elle préfère : recommencer sans se répéter.
(Texte rédigé avec l’aide de ChatGPT)